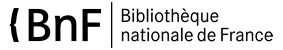« Il y a un esprit de la matière »
Au cœur de l’exposition consacrée par la BnF à Giuseppe Penone, le texte Sève et pensée est inscrit sur un tissu qui enveloppe un immense tronc d’arbre. L’artiste l’a écrit en italien et en a confié la traduction en français à l’écrivain Jean-Christophe Bailly. Chroniques les a réunis pour un entretien autour de cette méditation philosophique, poétique et esthétique.
Chroniques : Dans quelles circonstances le texte Sève et pensée a-t-il été écrit ?
Giuseppe Penone : Le point de départ de Sève et pensée, c’est la sculpture : un tissu de lin posé sur un tronc d’arbre et frotté avec des feuilles de sureau. L’action de ces gestes répétitifs de frottage révèle l’image sur le tissu. J’ai pensé que je pourrais associer à ce geste manuel celui de l’écriture. L’écriture est comme la sève qui irrigue la vie de l’arbre, elle porte un flux continu d’idées. J’ai commencé à écrire sur le tissu, sans préoccupation de forme, en laissant venir naturellement les images et les pensées.
Jean-Christophe Bailly, vous avez traduit Sève et pensée en français : comment avez-vous affronté ce texte fleuve qui se présente comme une seule phrase sans fin ?
Jean-Christophe Bailly : Traduire Sève et pensée a été une expérience très particulière. Une des difficultés résidait dans le fait qu’il n’y a aucune ponctuation, du début à la fin. En découvrant ce texte, puis en le traduisant, j’ai d’abord été frappé par le caractère ininterrompu de ce flux. C’est comme une montée de sève, et aussi une montée à la mémoire de toutes les œuvres antérieures de Giuseppe Penone. Peut-être à cause de la structure syntaxique du français, il a fallu ajouter à certains endroits des points de suspension, des virgules, introduire de petites césures dans cette continuité. Évidemment, on ne peut pas retrouver en français le chant de la langue italienne. Mais par moments, on arrive à entendre une mélodie dans la langue française. C’est un texte qu’il est important d’entendre dans sa forme orale.
Le texte tisse des fils qui relient l’humain à la nature, à la terre, au ciel, au vent…
G. P. : Dans son Essai sur la métamorphose des plantes, Goethe écrit que « dans la graine, il y a déjà l’arbre ». La graine contient le développement de l’arbre. L’idée de départ qui a inspiré l’écriture de Sève et pensée est qu’il existe une similitude entre les éléments naturels et l’humain. J’ai associé l’image de la graine à celle du cerveau. Ce que j’ai voulu dire aussi, c’est que la pensée est quelque chose de continu. De manière consciente ou inconsciente, nous pensons tout le temps, sous diverses formes – par le rêve notamment.
J.-C. B. : Cela me fait penser à ce que les botanistes appellent la dormance, cet état des semences qui peuvent être à la fois vivantes et non actives, parfois pendant des siècles ! Toutes leurs actions, leurs développements futurs sont déjà là et leur inertie n’en est pas une, c’est en fait un devenir. Une graine, c’est même, d’une certaine façon, une explosion en devenir ! C’est la même chose pour le cerveau. Il est en sommeil et soudain quelque chose l’atteint et le réveille, exactement comme la lumière pour la graine. Cette similarité n’est pas allégorique, c’est un mode de fonctionnement. Le philosophe grec Plotin disait que la nature elle-même est une méditation. En la voyant au travail, on la voit penser.
Votre travail s’attache à révéler les empreintes vouées à disparaître et à en garder trace : est-ce une façon d’assurer la permanence de l’être humain dans un monde où tout est en mouvement ?
G. P. : Les empreintes digitales de l’être humain, les traces qu’il laisse chaque jour autour de lui sont des images de son individualité. Mais c’est quelque chose que notre culture rejette, qui est considéré comme « sale » et qu’il nous est imposé d’effacer, pour des raisons d’hygiène notamment. C’est le contraire de ce qui anime l’œuvre d’art, la volonté d’exprimer l’identité d’un individu, de marquer sa présence au monde. Mais en même temps, le fait d’effacer les empreintes permet que d’autres empreintes se déposent, c’est le cycle de la vie.
J.-C. B. : Sève et pensée évoque d’ailleurs une œuvre du Jardin des sculptures fluides réalisée par Giuseppe Penone à La Venaria Reale, près de Turin. Il s’agit d’un bassin animé par des bulles d’air qui dessinent une empreinte digitale à la surface de l’eau. Elle apparaît, puis disparaît, illustrant l’idée que l’identité elle-même est un passage. Cette référence au temps est partout dans le travail de Penone, y compris dans Sève et pensée que l’on peut lire comme une méditation sur le temps, dans le temps et avec le temps.
L’exploration du monde par les sens est une constante de votre travail ; quelle est la place que vous donnez au toucher ?
G. P. : Mon intérêt pour le toucher trouve ses racines dans les débuts de mon travail, au cours des années 1960. Cette époque a été marquée par le désir de beaucoup de créateurs de remettre en cause les conventions de l’expression artistique. Le toucher était pour moi le sens qui pouvait adhérer le plus fortement à la réalité, annuler les conventions. C’est sans doute la raison pour laquelle les artistes de cette génération ont utilisé la sculpture ou d’autres modes d’expression dans l’espace, davantage que la peinture, qui est par définition une convention : la composition du tableau, par exemple, détermine déjà l’histoire qu’il raconte. Cette volonté de coller à la réalité a guidé mon travail depuis Il poursuivra sa croissance sauf en ce point (1968) : ce moulage en bronze de ma main, pris dans le tronc d’un arbre, met mon corps sur le même plan qu’un élément végétal. C’est la poussée de l’arbre qui a créé l’empreinte de ma main à l’intérieur de sa matière.
J.-C. B. : Ce point de vue sur le toucher incite à repenser l’importance de la surface. Pour le sens commun, la surface est considérée comme ce qui masque la profondeur. Or pour Giuseppe Penone, la surface constitue, bien au contraire, le mode d’apparition de la profondeur. Ainsi la peau est avant tout une interface entre le dedans et le dehors. Grâce au toucher, notre sens le plus matériel, longtemps méprisé comme un peu vulgaire, nous avons un contact direct avec le monde. Par ailleurs, le sens de l’odorat est également convoqué, via l’odeur du laurier par exemple. Je me souviens de cette phrase de Respirer l’ombre (1999), recueil de pensées de l’artiste sur une longue période : « L’idéal serait de faire une sculpture qui serait comme l’odeur du pain. »
Cette célébration de la matière se traduit chez vous par une fascination pour le bois, l’argile, le bronze…
G. P. : Il y a un esprit de la matière. Le bois est une matière formée par un être vivant qui mémorise dans sa structure la forme de sa vie. Symboliquement, c’est comme si un sculpteur produisait une œuvre qui contiendrait sa propre nécessité à chaque moment de sa vie. Quant à l’argile, elle est d’une incroyable séduction lorsqu’elle est mouillée. Cette sensualité extraordinaire qui rappelle la chair est également présente dans le bronze. Quand il est poli, il a un aspect lumineux qui donne une impression de vie : il dégage une lumière, une énergie. J’ai utilisé le bronze pour sa capacité à imiter la végétation. La patine qui se forme à cause de l’oxydation s’intègre dans la végétation qui l’entoure – et dans nos climats pluvieux, la réaction se poursuit au cours du temps.
J.-C. B. : Dans ses réflexions sur les matières, Penone inclut aussi le minéral, que ce soit la pierre ramassée dans un torrent ou le marbre. Alors que le minéral est en général perçu comme totalement mort, inerte, il le considère comme le moment d’un devenir. C’est ce que nous dit l’expression « les veines du marbre » : le marbre, lui aussi, est une matière vivante.
G. P. : Nous voyons la réalité qui nous entoure à travers la forme de notre corps et ses composantes, le sang, les veines. À propos de la vitalité de la matière, la science nous dit de plus en plus que le cosmos est vivant, que les pierres sont vivantes, même si c’est une vie différente de la nôtre et donc difficile à concevoir.
J.-C. B. : À cet égard, la sculpture intitulée Être fleuve (1981) est pour moi une œuvre-clé. Il s’agit d’une pierre trouvée dans un fleuve, présentée avec son double sculpté à l’identique. Giuseppe Penone a ainsi produit de ses mains une pierre en tous points semblable à celle que l’eau du fleuve a longuement roulée et pétrie. Ce qui compte ici, ce n’est pas la ressemblance mimétique – qui pourtant est parfaite –, c’est l’identification au travail du fleuve, autrement dit au devenir, au temps.
G. P. : Ce que je voulais faire dans cette œuvre, c’était restituer l’action du fleuve sur la pierre. Avec l’intuition que le travail du sculpteur sur la pierre, c’est un peu comme l’action du fleuve. Pour que la sculpture prenne son sens, il fallait mettre en regard les deux pierres, celle façonnée par le fleuve et celle que j’ai réalisée.
Pour vous, Giuseppe Penone, le livre est une source d’inspiration, mais aussi un objet à explorer dans ses composantes matérielles. Sans être bibliophile, vous collectionnez des éditions originales de textes essentiellement poétiques : pourquoi ?
G. P. : Le livre, c’est d’abord pour moi un objet physique, proche de notre corps, qui ressemble à une main qui se ferme et qui s’ouvre. Lorsque nous touchons un livre, nous laissons sur lui une empreinte, et des parcelles de sa matière se déposent sur nos mains, puis se disséminent dans l’espace. Ces questions m’inspirent.
Et puis je crois qu’un être humain qui publie son premier livre, souvent dans sa jeunesse, y met une part essentielle de lui-même – ses espoirs, ses émotions, le germe de son œuvre future. Chaque première édition a une histoire particulière. Souvent l’auteur l’a prise dans ses mains, l’a regardée, l’a touchée. Il a eu une relation forte avec cet objet. Ainsi Jorge Luis Borges avait mis des volumes de son premier livre, Fervor de Buenos Aires (1923), dans les poches des manteaux des membres d’un club littéraire, puis était parti en voyage avec son père. Quand il est rentré à Buenos Aires, son livre avait commencé à avoir du succès !
Vous revenez à plusieurs reprises sur la capacité de l’art à étonner et à émerveiller.
G. P. : Oui, c’est l’émerveillement de l’enfant, ou l’étonnement du voyageur fasciné par ce qu’il découvre à son arrivée dans une terre inconnue. Chacun peut ressentir ce sentiment face à une œuvre dont il ne comprend pas exactement la raison d’être, ni pourquoi elle a cette forme. La compréhension logique de ce que l’on a sous les yeux échappe et laisse place à un état de surprise, d’émotion, d’incrédulité. Cette dimension est essentielle. Toutes les œuvres qui ont survécu dans le temps possèdent cette capacité à faire naître l’émotion.
J.-C. B. : Je pense à une phrase de Novalis qui pourrait être mise en exergue du travail de Giuseppe Penone : « J’appelle nature la communauté merveilleuse où nous introduit notre corps. » Aujourd’hui, des penseurs, des scientifiques ou même des philosophes essaient de rétablir ces liens avec la nature qui ont été défaits. Giuseppe Penone montre ces liens au travail, il va au contact de cette communauté-là, et ce faisant il crée des œuvres qui émerveillent.
Propos recueillis par Sylvie Lisiecki
Article paru dans Chroniques n° 92, septembre-décembre 2021
En savoir plus sur l’exposition Giuseppe Penone, sève et pensée