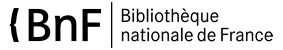Regarde un peu la France
À l’occasion de l’exposition La France sous leurs yeux, présentée sur le site François-Mitterrand, Chroniques a réuni cinq des 200 photographes lauréats de la grande commande pour le photojournalisme : Jean-Michel André, Céline Clanet, Alain Keler, Stéphanie Lacombe et Véronique de Viguerie reviennent sur leur expérience et partagent les réflexions que cette commande historique a fait naître.
Chroniques : La grande commande pour le photojournalisme avait pour titre « Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire » : comment y avez-vous répondu ?
Céline Clanet : Le mot de « radioscopie » m’a parlé, j’y ai vu comme un scan du territoire français : j’imaginais ces 200 photographes envoyés à travers le pays pour le scanner ! Le sujet que j’ai choisi de traiter ne relève pas à proprement parler de la crise sanitaire : j’ai photographié des espaces naturels dits en « libre évolution », des réserves intégrales protégées soit par l’État soit par des particuliers ou des associations. La grande commande m’a donné l’opportunité de creuser un sujet que je n’avais pas abordé auparavant et de le faire en France, où j’avais peu travaillé jusqu’ici.
Stéphanie Lacombe : J’avais déjà mon sujet en tête quand le confinement est arrivé. J’avais fait une résidence dans la Somme, à l’internat de la cité scolaire de Flixecourt. C’est là que je me suis rendu compte de la nécessité de revenir réaliser un projet plus large, pour aborder les inégalités de revenus des habitants des communes rurales et l’enclavement de la jeunesse qui y vit. L’appel à projet de la grande commande a été merveilleux : c’était pile poil dans ce que j’avais l’intention de faire.
Jean-Michel André : Ça fait une dizaine d’années que j’arpente le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, pour des commandes institutionnelles et dans le cadre de résidences, en travaillant avec les habitants. C’est l’une des régions qui a subi de plein fouet la crise sanitaire, avec une paupérisation très élevée. Pour moi, le sujet a été une évidence : c’était l’occasion de porter un regard personnel sur la mémoire et les évolutions de ce territoire qui a vécu trois siècles d’exploitation minière et traversé de nombreuses crises, mais qui a toujours su se relever.
Véronique de Viguerie : Je viens du monde rural du Sud de la France, mon père et mon grand-père sont chasseurs, mes oncles sont agriculteurs, et je ressentais depuis des années une fracture grandissante entre la ruralité et les grandes villes, qui est devenue flagrante avec le Covid. Explorer cette fracture, j’y pensais depuis longtemps, mais je ne l’aurais jamais fait sans la grande commande. Mon reportage portait au départ sur le difficile partage de la nature entre citadins et ruraux et s’est progressivement focalisé sur les chasseresses. Et puis je travaille très peu en France, ça m’a permis de découvrir le pays ! [rires]
Alain Keler : Comme Véronique, j’ai beaucoup voyagé et peu travaillé sur la France. Pour les photojournalistes de ma génération, faire du reportage, c’était aller le plus loin possible ! La grande commande m’a donné l’occasion de revenir sur les lieux de mon enfance, en Auvergne. Je voulais travailler sur les petits villages, ces lieux dans lesquels j’ai grandi et qui sont traversés par mon histoire familiale. Je suis retourné là où mes grands-parents, juifs polonais, sont venus chercher un refuge, avant d’être dénoncés et déportés dans les camps, où ils sont morts avec leur fille. C’est un travail introspectif et personnel que je n’aurais jamais pu faire pour la presse.
Outre le cadre géographique du territoire français, la grande commande proposait un calendrier défini : vous aviez sept mois pour effectuer le reportage, trois pour en assurer la post-production. Comment avez-vous organisé votre temps ?
Jean-Michel André : J’ai une approche documentaire, je travaille habituellement pendant deux ou trois ans sur un sujet. Sept mois, c’est à la fois long et court. Dans le cas de la grande commande, ce qui était précieux, c’était de pouvoir se concentrer à 100 % sur un sujet.
Céline Clanet : Moi, j’ai trouvé ça court ! Comme pour Jean-Michel, un projet me prend d’habitude entre trois et cinq années. Là, j’ai pu me rendre dans 19 réserves, mais j’aurais aimé en faire bien plus. Les prises de vue ont commencé en février, et comme mon sujet implique d’être tout le temps dehors, ça n’était pas forcément très simple, la météo était souvent mauvaise et sombre. Mais finalement cette contrainte m’a aidée à homogénéiser le projet et j’en ai pris mon parti : les très basses lumières, les tons marron ont constitué une palette hivernale que j’ai ensuite gardée pour toute la série.
Véronique de Viguerie : Dans mon cas, la contrainte temporelle était davantage liée à la saison de la chasse, qui commence en septembre. Les photos devant être rendues à l’automne, il a fallu aller très vite !
Alain Keler : J’ai eu une impression de liberté totale, due à la fois au calendrier et à la dotation : je n’ai jamais touché autant d’argent ! [Chaque photographe de la grande commande a reçu un financement de 22 000 euros]
Stéphanie Lacombe : C’était une très belle dotation, et je tiens à dire que c’était une dotation juste. On nous a donné un montant qui correspond au travail fourni et qui comprend la préparation, les repérages, la post-production, la sélection des images, la rédaction des légendes, les tirages… Et puis, je me suis dit : « Putain, c’est la BnF, quoi ! » Une vraie carte blanche, comme on en rencontre rarement. Il fallait être à la hauteur : c’était à la fois compliqué, parce que le sujet était difficile à traiter, et hyper stimulant !
Alain Keler : Ah oui, c’était sérieux, pas comme la presse ! [rires] J’ai pu dessiner le projet au fur et à mesure, sans personne pour me dire : « Eh coco, faut faire ci ou ça ! » J’ai trouvé ça fabuleux…
Stéphanie Lacombe : La deadline m’a plutôt obligée à accélérer, à réaliser le reportage en moins de temps que ce que j’avais prévu. Mais dans chaque projet que j’entreprends, arrive l’instant où je me dis : « Ça y est, je suis allée au bout » et où je remballe tout. Là, j’avais mis toutes mes affaires dans la voiture. C’était un jour de réderie – le nom qu’on donne aux vide-greniers dans la Somme. Et je croise Marjorie, à son stand, devant sa maison. J’avais cherché à la photographier sans succès pendant des mois : à chaque rendez-vous, elle me laissait un petit mot sur sa porte pour s’excuser. Je pense qu’elle avait un peu le trac de se faire photographier avec sa famille. À ce moment-là, elle me dit : « On n’a qu’à le faire maintenant ! » C’était trop beau, je suis allée chercher mes affaires dans la voiture et j’ai fait la photo qui est dans le reportage : Marjorie devant chez elle avec ses enfants, la petite dernière au biberon. Pour l’anecdote, juste après cette photo, je repars et je croise une majorette. Dans ces territoires, le costume, l’uniforme – que ce soit pour les majorettes, les pompiers bénévoles, les enfants de chœur –, c’est très important et valorisant. Je me suis dit : « Il me la faut dans le projet. » Puis : « Non, c’est vraiment fini. » Et je suis partie. Encore aujourd’hui, je regrette de ne pas avoir fait cette photo. Mais il faut qu’à un moment, le projet se termine.
Véronique de Viguerie : La photo qu’on ne fait pas, c’est parfois celle qui reste…
Stéphanie Lacombe : Oui, c’est celle à laquelle je pense le plus !
En parlant de rencontres, quelles sont celles qui vous ont marqués au cours des reportages effectués pour la grande commande ?
Jean-Michel André : Parmi toutes les rencontres faites dans le bassin minier, il y en a une qui est fondamentale pour moi, c’est celle de Thibaut. Un jour, je suis en repérage sur le terril de Noyelle-sous-Lens, et je vois ce jeune homme faire des saltos et des acrobaties assez dingues. Je ne l’ai pas photographié ce jour-là. Quand on s’est revu, j’ai pris une photo de lui devant un terril qui reverdit : il a les pieds en l’air, la tête en bas et les yeux grands ouverts. Si les traces du passé sont bien présentes, l’image souligne les mutations du paysage et de ses usages, dans un moment de bascule. Elle porte une symbolique forte, une jeunesse à la fois sens dessus dessous et concentrée pour ne pas perdre l’équilibre, prête à retomber sur ses pieds. Thibaut faisant de la voltige sur le terril 101, c’est l’élément déclencheur de mon projet. Je fonctionne souvent comme ça, avec une photo autour de laquelle s’articule mon récit.
Véronique de Viguerie : Un moment marquant pour moi a été la transhumance avec Marie, une bergère qui garde 600 brebis béarnaises. Quatre jours de pure tranquillité, à regarder, observer, humer la nature. Ça ne m’arrive jamais, ça !
Alain Keler : Alors moi, ce ne sont pas des brebis, mais des vaches… [rires] En quittant une nationale, je traverse un petit village et un troupeau me coupe la route, avec un paysan, vraiment à l’ancienne. Je l’accompagne dans l’étable, avec cette odeur de bouse que je trouve très agréable. On va chez lui. Il vit dans un foutoir pas possible. Il a envie de parler. Il me raconte qu’il a voulu se marier, que sa mère s’y est opposée et qu’il est resté célibataire. Qu’il est rarement sorti de chez lui, une fois à Clermont et une fois à Saint-Étienne pour le foot. Je le prends en photo, son portrait fait partie des dix tirages sélectionnés pour les collections de la BnF. Je vais retourner le voir pour lui en donner un exemplaire, j’espère qu’il sera toujours en vie. J’aime bien le hasard en photo : si j’étais arrivé dix minutes avant ou après les vaches, il n’y aurait pas eu de rencontre.
Céline Clanet : Moi qui ai passé 80 % du temps seule dans des forêts, j’imaginais faire une série de paysages et je ne m’attendais pas à rencontrer autant d’humains ! Finalement il y a des portraits dans le reportage. Des gens qui dédient leur vie à ces endroits, des personnalités ahurissantes, à l’image de Joseph Garrigue, qui inventorie littéralement tous les arbres de la réserve de la forêt de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales. Ou de Christian Petty, qui a racheté 300 hectares dans l’Hérault, il y a quarante ans, pour les sanctuariser envers et contre tous. J’ai énormément appris à leur contact et ça a influencé mes images. Sans eux, je n’aurais sans doute pas fait autant de gros plans de bois mort en métamorphose, parce que cet élément est au cœur de la notion de libre évolution des espaces naturels.
Une des possibilités offertes par la grande commande était de participer à un journal de bord collectif, mis en ligne au fur et à mesure que les reportages étaient réalisés. Alain et Jean-Michel, vous vous êtes prêtés à l’exercice : que vous apporte cette pratique du journal ?
Alain Keler : Je tiens un journal en ligne que j’alimente presque quotidiennement. Pour moi, dans la photo, il y a le cadre noir autour d’une image que je ne recadre jamais, à la Cartier- Bresson, et puis il y a tout ce qui l’entoure et reste invisible. Dans ce hors-cadre prend place le ressenti du photographe, parfois aussi important que l’image : il ne peut être qu’écrit. L’écriture accompagne toujours mon travail, elle le complète. Jean-Michel André : Mener un journal de bord m’a permis d’aller au-delà du récit photographique. Il fallait donner des clés de compréhension pour appréhender ces paysages et sites miniers : des faits, des dates, des cartes. Le journal m’a aussi permis de donner une place aux photographies non retenues pour le reportage, comme le portrait d’un ancien mineur qui a été une rencontre importante pour moi. J’accorde beaucoup d’importance à l’écrit mais c’est la première fois que je partage un journal de bord.
Céline Clanet : À l’inverse, je pars du principe que tout ce que j’ai à dire est dans les images, et que tout ce qui concerne le processus est anecdotique. Je tiens un carnet dans lequel je prends énormément de notes, mais ça ne me viendrait jamais à l’idée de le partager ! Ce serait rendre visible quelque chose d’intime que je ne veux pas montrer. Un peu comme les filles qui se maquillent dans le métro : quand je les vois, je suis sidérée, je me dis : « Mais pourquoi font-elles ça ?!? » [rires] Et je dois avouer que les journaux des autres photographes, ça ne m’intéresse pas…
Stéphanie Lacombe : … alors que moi, j’adore ! Je trouve qu’il y a de très beaux carnets, contrairement aux miens qui sont moches et pleins de fautes d’orthographe. Je les porte autour du cou, avec mes stylos, pour pouvoir noter immédiatement ce que les gens me racontent. Mes carnets et mes stylos sont aussi importants que mes appareils. Mais je ne veux pas partager ce qui relève de mes doutes ou de mes émotions. Ce que vivent les gens que je rencontre est tellement plus difficile. En revanche, à l’occasion de la grande commande, j’ai publié sur mon Instagram des travellings vidéo : je filmais les trajets que j’accomplissais en voiture pour aller à certains rendez-vous qui me semblaient importants sur l’instant.
Véronique de Viguerie : Je n’ai pas du tout l’habitude d’écrire, ce n’est pas mon mode de fonctionnement, et ça me demande beaucoup d’énergie ! Peut-être parce que d’ordinaire, pour la presse, je pars avec un rédacteur ou une rédactrice : ce sont eux qui parlent avec les personnes rencontrées pour nos reportages. Moi j’essaie au maximum de me faire oublier, de disparaître. Je m’applique à intervenir le moins possible… Pendant que vous arpentiez la France en 2021 et 2022, l’actualité nationale et internationale a suivi son cours, parfois dramatique : comment l’irruption de la guerre aux portes de l’Europe et de la crise économique a-t-elle influé sur vos travaux ?
Alain Keler : Au début de la guerre en Ukraine, j’étais en Auvergne et j’ai eu un problème médical qui m’a contraint à rester en France. Ça m’a pris la tête grave – je l’ai écrit dans mon journal. J’y ai repensé il y a quelque temps, à l’occasion d’une visite au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Il y a là un lieu de mémoire dédié à l’histoire des Justes et des résistances pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut y voir un film sur l’Exode de 1940. L’exode, c’est ce que j’aurais voulu photographier dans les premiers temps de la guerre en Ukraine. Après, c’était trop tard.
Véronique de Viguerie : Moi j’ai pu aller en Ukraine, parce que ce n’était pas pendant la saison de la chasse ! J’ai aussi continué à partir en Afghanistan que je couvre depuis une vingtaine d’années : il y a des sujets qu’on ne peut pas trop refuser – les femmes afghanes pour moi, par exemple. Comme la chasse a lieu le week-end et le mercredi ou le mardi dans certaines régions, je me suis débrouillée pour caler les autres reportages en faisant du Tetris avec mon agenda.
Stéphanie Lacombe : La Somme fait partie de ces territoires où les populations se sentent abandonnées par les politiques. À cet égard, l’actualité économique a été centrale : on était en pleine période d’inflation, le pouvoir d’achat était dans toutes les têtes. Parler d’argent aux gens que je rencontre, c’est compliqué : je ne peux pas leur demander à brûle-pourpoint comment ils s’en sortent. En revanche, l’inflation, en tant que sujet de société, permet d’amorcer la discussion. Et très vite, la politique s’invite dans la conversation, via l’insécurité, la place de la jeunesse, les problèmes de mobilité : ce n’est pas un hasard si les véhicules – voitures, mobylettes, vélos – sont très présents dans mes photos.
Jean-Michel André : Le bassin minier, c’est une terre de courage et de solidarité, habitée par 29 nationalités venues pour travailler ensemble dans les entrailles de la terre. Mais la fraternité y est aujourd’hui mise à mal par les politiques nationales et internationales. Il faut être vigilant pour ne pas tomber dans la banalisation, dans l’indifférence. Ma démarche s’appuie sur une vision à la fois politique et poétique. Le paysage y est très présent, tout comme le vivant, qu’il s’agisse des humains ou des animaux. Je vais à l’encontre du pathos, du spectaculaire et des clichés souvent véhiculés sur ce type de territoire. Et en ce sens j’aime beaucoup le reportage de Stéphanie dans la Somme, je le trouve très juste.
Céline Clanet : À première vue, on ne dirait pas, mais les réserves intégrales et la libre évolution sont des sujets éminemment politiques. J’ai surtout pu le constater dans les territoires privés où des militants anticapitalistes s’attachent à sanctuariser les espaces naturels. Ils lèvent des fonds, parfois des millions d’euros, pour acheter des centaines d’hectares où ils ne feront strictement rien. L’engagement politique est là, plutôt que dans les espaces gérés par l’État, où l’enjeu est davantage celui de l’exploration scientifique. Cette démarche désintéressée me semble complètement dingue, et j’étais très étonnée de voir l’ampleur qu’elle peut prendre. Ça m’a donné beaucoup d’espoir.
Véronique de Viguerie : Le fossé entre les espaces urbains et naturels, entre le chasseur et le gibier, touche à la question du vivre ensemble. De nombreux reportages de la grande commande l’abordent également, sous des angles différents. En côtoyant ces chasseresses, dont certaines pratiquent la chasse pour entretenir une relation avec leurs animaux (des chiens, des aigles, des furets), j’ai moi aussi eu beaucoup d’espoir : c’est peut-être par les femmes que l’on peut arriver à réduire les écarts, à trouver l’équilibre.
Propos recueillis par Mélanie Leroy-Terquem
Entretien paru dans Chroniques n° 100, mars-juillet 2024