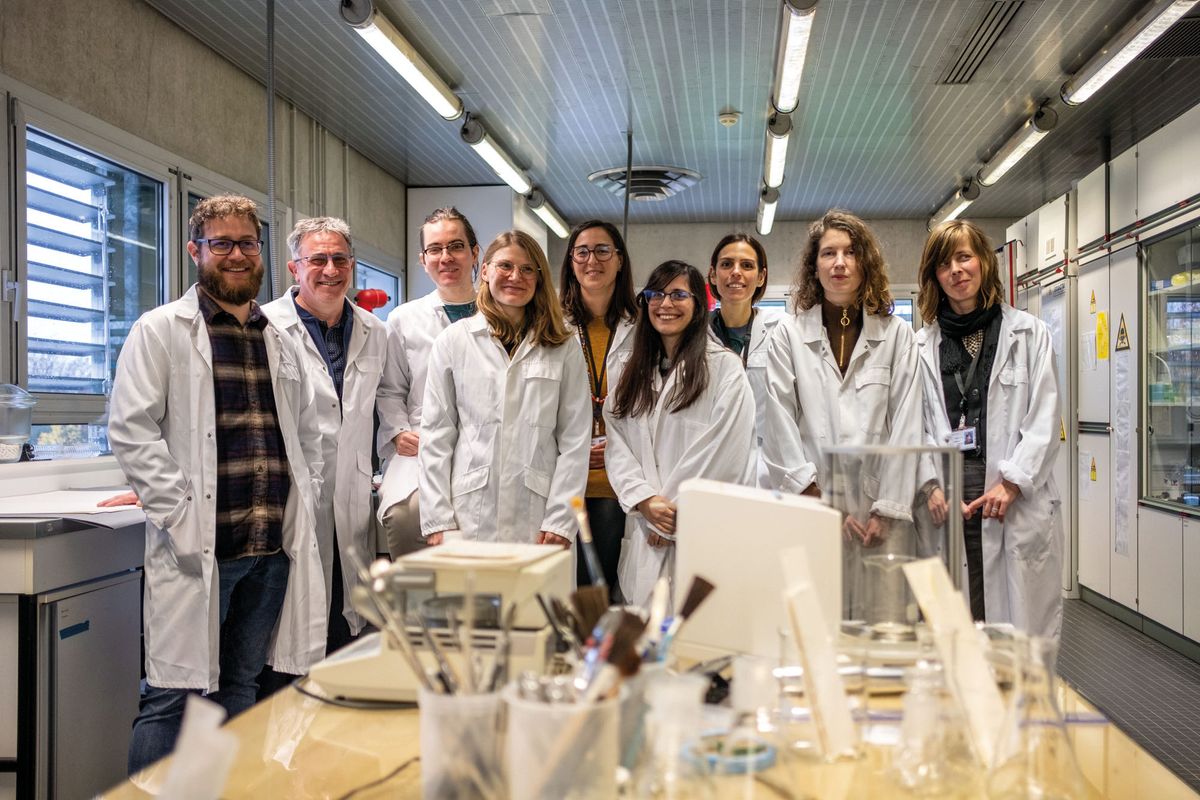Dans le laboratoire de la BnF
La BnF est l’un des rares établissements culturels français à disposer en interne d’un laboratoire scientifique et technique. Actuellement réparti sur le site François-Mitterrand et le centre de Bussy- Saint-Georges, le laboratoire de la BnF est composé d’une équipe de dix chimistes et biologistes qui travaillent au service des collections et participent à plusieurs programmes de recherche internationaux. Visite guidée.
« C’est un labo qui ressemble à ce qu’on peut trouver dans les domaines de l’agroalimentaire ou de la médecine, sauf qu’ici, on travaille pour le patrimoine », explique Stéphane Bouvet en faisant visiter le laboratoire de la BnF dont il est responsable, sur le site de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Les dix techniciens, ingénieurs en chimie ou biologie et postdoctorants qui y travaillent sont amenés à se déplacer régulièrement sur le site Richelieu, à la bibliothèque de l’Arsenal, à la bibliothèque-musée de l’Opéra et sur le site François-Mitterrand qui accueillera l’ensemble du laboratoire en 2030, quand la BnF quittera Bussy-Saint-Georges.
Au service des collections de la BnF et d’ailleurs
Pour l’heure, les machines installées dans les trois pièces en enfilade produisent un bruit de fond continu : deux enceintes climatiques vrombissent et sifflent à intervalle régulier tandis que, plus loin, bourdonnent des appareils de chromatographie. « Les experts et chercheurs qui utilisent ces équipements travaillent pour la santé des collections de la Bibliothèque, mais aussi de celles des institutions patrimoniales qui font régulièrement appel à nous », souligne Olivier Piffault, directeur du département de la Conservation dont dépend le laboratoire. Ainsi la petite bête duveteuse dotée de mandibules acérées, affichée sur l’écran relié à un microscope numérique, est une larve prélevée sur un costume conservé dans un musée français qui a fait appel au pôle biologie-environnement du laboratoire.
Pour traiter ce type d’infestations, le centre technique de Bussy-Saint-Georges dispose d’une chaîne d’anoxie permettant de tuer les insectes par privation d’oxygène. Ce jour-là, elle accueille des documents issus des collections du département des Arts du spectacle : deux costumes et quatre marionnettes attendent sagement dans leur bulle de plastique transparent la fin d’un traitement de trois semaines. « Les costumes ont été exposés au musée de la BnF dans le cadre de la présentation sur Beaumarchais, précise Valentin Rottier, technicien de recherche au laboratoire. Avant qu’ils ne retournent en magasin, ils sont traités ici à titre préventif. Parmi nous, il y a d’ailleurs une chargée de recherche dédiée à tout ce qui a trait au musée, aux expositions et aux prêts d’œuvres. »
En cas de contaminations biologiques importantes par des moisissures et des bactéries, une unité de désinfection de 6 m3, que seuls deux membres du laboratoire sont habilités à faire fonctionner, permet de traiter les documents à l’oxyde d’éthylène. La BnF étant l’une des rares institutions culturelles françaises à posséder un tel équipement, elle est souvent sollicitée par des bibliothèques ou centres d’archives.
De la conservation préventive à l’analyse des documents
L’expertise du laboratoire de la BnF, riche de plusieurs dizaines d’années d’expérience, ne se résume pas à l’identification et au traitement des nuisibles. Elle s’exerce dans différents domaines – à commencer par la conservation préventive : les produits et matériaux utilisés pour la conservation des collections de la Bibliothèque dans les magasins comme dans les espaces d’exposition sont testés, depuis les cartons et papiers jusqu’aux cuirs et colles, en passant par les encres qui servent à estampiller les documents. L’expertise physicochimique ou biologique du laboratoire est aussi sollicitée par les chargés de collections : les membres de l’équipe viennent faire des prélèvements sur place ou transportent avec eux les appareils nécessaires. Le spectromètre infrarouge, l’analyseur à fluorescence X et le microscope digital ont par exemple voyagé jusqu’à la bibliothèque de l’Arsenal au moment de l’acquisition du manuscrit en rouleau des 120 Journées de Sodome. « On y a passé deux jours, se souvient Eleonora Pellizzi, coordinatrice de la recherche au sein du laboratoire. Les conservateurs cherchaient à comprendre comment Sade, dans sa cellule de la Bastille, a pu confectionner de la colle pour assembler les différents feuillets. Ils voulaient aussi identifier les encres et analyser les taches présentes à certains endroits sur le papier : on y a trouvé des traces d’arsenic ! »
Des programmes de recherche ambitieux
La réputation du laboratoire l’a progressivement conduit à participer à des projets de recherche de grande ampleur, en collaboration avec d’autres institutions nationales ou internationales. Il accueille actuellement deux post-doctorantes : l’une participe à un programme d’analyse des encres des estampes réalisées à Fontainebleau et Paris au XVIe siècle, l’autre travaille sur l’évaluation des composés organiques volatils présents à proximité des collections – un projet financé par le plan quadriennal de la BnF. « C’est un privilège rare de pouvoir travailler au sein même d’une institution culturelle, note Eleonora Pellizzi, qui mène depuis plusieurs années, en collaboration avec le Centre Pompidou, un projet de recherche autour de la conservation d’objets en caoutchouc. On fait un super métier ! »
Mélanie Leroy-Terquem
Article paru dans Chroniques n° 102, janvier-mars 2025