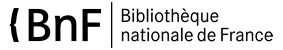Françoise Pétrovitch, l’estampe en liberté
À partir du dessin, d’où émergent ses créations, Françoise Pétrovitch expérimente avec un désir toujours renouvelé les supports, les formats, les matériaux. Entretien.
Chroniques : Depuis le dessin, la gravure et la peinture jusqu’à la céramique et aux sculptures de bronze, votre œuvre se décline sur des supports et des formats très différents. Quel est le moteur de cette diversité ?
Françoise Pétrovitch : Je crois que c’est la curiosité, le doute, l’envie d’apprendre, toujours. Expérimenter d’autres techniques permet, en redevenant débutante, de revenir à l’essentiel, de se poser les bonnes questions : quel est le sens de ce que je fais, quel médium pour quelle forme, quel est l’esprit qui doit perdurer ?
Vous dites que le dessin, spontané, sans esquisse préalable, est « la colonne vertébrale de [votre] travail »…
J’aime dans le dessin sa liberté et sa rapidité, cette énergie immédiate que j’essaie de retenir. Le dessin nécessite peu de matérialité, il est en cela proche de l’écriture. Je réalise aussi bien des miniatures que des dessins muraux pour lesquels j’interviens dans des lieux qui peuvent être vastes : on se déplace alors dans les lignes qui nous entourent. Et les sculptures, qu’elles soient en céramique ou en bronze, émergent toujours du dessin.
L’enfance et l’adolescence sont des motifs récurrents dans votre travail. Qu’est-ce qui vous inspire dans ces sujets ?
Ce sont des moments de devenir, de mobilité, d’entre-deux, où tout est possible (ou rien d’ailleurs…). Je note les attitudes, les positions de ces corps en train de changer. Il y a une grâce particulière dans les gestes des adolescents que j’aime beaucoup.
Vous avez réalisé de nombreux livres avec des écrivains ; quel est votre rapport à la littérature et aux auteurs ?
Je suis fascinée par les écrivains et l’écriture. La narration suppose un temps déroulé, alors qu’une œuvre plastique se saisit en un instant global. Je pense que ces deux temps différents se complètent et s’interrogent. Le projet Radio Pétrovitch que j’ai mené de 2000 à 2002 est venu du désir de me confronter à cette question du temps. J’ai enregistré la première information que j’entendais à la radio le matin sur France Inter. Je l’enregistrais et réalisais un petit dessin. Dans la journée je faisais un autre dessin qui représentait un moment de ma vie, comme un journal intime. Avec la mise en vis-à-vis des deux expositions images se créait un diptyque dont les éléments n’avaient de commun que le fait d’être produit par la même personne. J’ai tenu cela pendant deux ans ; ainsi le projet se constitue de 1 370 dessins qui correspondent à ces deux années d’écoute.
Il s’agit d’un travail sur l’archive, sur la mémoire, une mémoire dessinée. Dans l’exposition seront présentés certains des classeurs du projet; trois d’entre eux seront ouverts et permettront de retrouver ainsi des informations qui ont marqué notre quotidien pendant cette période, entre le collectif et l’intime.
Pourquoi avoir choisi pour titre de l’exposition Derrière les paupières ?
Nous avons choisi ce titre parce qu’il résonnait comme un regard intérieur. Il évoque une image qui n’est pas visible, qui est en quelque sorte réinventée par chaque visiteur à partir de ce qu’il a vu. Cela correspond aussi à une volonté de faire surgir des questionnements sur ce qui est montré : il y a toujours quelque chose d’autre derrière, quelque chose qui nous hante peut-être… C’est une invitation à traverser les apparences.
Propos recueillis par Sylvie Lisiecki
Entretien paru dans Chroniques n° 95, septembre-décembre 2022