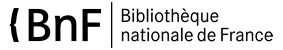Biographe de Hergé et de Derrida, auteur avec François Schuiten du cycle Les Cités obscures, Benoît Peeters publie aux Éditions de la BnF La Bande dessinée entre la presse et le livre. Fragments d’une histoire. Rencontre avec celui qui se définit comme un « scénariste orienté image ».
Pour écrire La Bande dessinée entre la presse et le livre, vous avez utilisé les collections de journaux des XIXe et XXe siècles disponibles dans Gallica…
J’ai utilisé le plus possible le très riche fonds disponible sur Gallica, qui est une source infinie de découvertes. La numérisation de la presse par la BnF, mais aussi le travail effectué par la
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême ou par des sites comme
Töpfferiana, ont permis un changement de regard. Ils ont montré que l’histoire de la bande dessinée, en s’appuyant presque exclusivement sur les albums imprimés, avait minimisé le rôle joué par la presse, mais aussi par l’imagerie populaire d’Épinal.
On a maintenant une vue plus large sur cette histoire que l’on est amené à réécrire, ou à écrire autrement. Entre le moment où j’ai commencé à m’intéresser à la bande dessinée, dans les années 1980, et aujourd’hui, la perspective a totalement changé. Par exemple, la naissance de la bande dessinée a longtemps été fixée aux États-Unis à la fin du XIXe, alors que l’on considère désormais que ses débuts prennent place en Europe au début du XIXe siècle.
Cela invite aussi à reconsidérer les définitions strictes ou étroites de la bande dessinée, en prenant en compte des formes-limites de récits illustrés, qu’il s’agisse de bandes dessinées muettes ou de formats qui placent le texte ailleurs que dans des bulles… J’ai toujours été favorable à une définition poreuse de la bande dessinée.
Alors comment définir la bande dessinée ?
La bande dessinée, c’est une co-présence d’image et de texte, une intention narrative dans une succession de dessins qui se déploient dans un espace, la page. Un de ses traits essentiels, c’est le papier et la reproductibilité - que l’on soit dans le monde de la presse ou dans celui du livre. La dialectique entre la presse et le livre est d’ailleurs l’une des deux variables qui la caractérisent, l’autre étant celle qui la fait osciller entre le public enfantin et le public adulte.
La bande dessinée est, au départ, un support pour adulte, que l’on pense à Rodolphe Töpffer, à Gustave Doré, ou à la caricature anglaise. La spécialisation enfantine arrive assez tard, et elle coexistera avec une bande dessinée adulte ou familiale - à l’image des
Peanuts de Schultz, ou de
Little Nemo de Winsor McCay, qui s’adressent à tous les publics.
Y a-t-il une spécificité de la bande dessinée de presse ?
La bande dessinée publiée dans la presse - je pense par exemple à 13 rue de l’espoir, de Paul Gillon, paru dans France-Soir entre 1959 et 1972 - a offert à ses lecteurs des personnages représentant leur temps, des supports d’identification familiers, un peu à l’image de feuilletons télévisés comme Plus belle la vie. Ce type de rendez-vous n’existe plus aujourd’hui : la grande presse s’est progressivement désintéressée de la bande dessinée, après s’être désintéressée du feuilleton littéraire - et on sait le rôle que cela avait joué pour le roman du XIXe siècle !
La forme hebdomadaire, dont il subsiste des traces dans L’Obs avec Les Cahiers d’Esther de Riad Sattouf, c’est encore autre chose : il y a davantage de contenu, une page assez dense, mais c’est différent de ces retrouvailles quotidiennes qui faisaient la spécificité du strip.
L’autre point qui me semble important, c’est que la lecture du journal est fondamentalement différente de la lecture de l’album. Dans des parutions comme Le Journal de Spirou, Pilote ou encore Métal hurlant, il y a des rythmes internes qui sont aussi attachants que telle ou telle série vedette : l’alternance de sérieux et d’humour, de séries majeures et de séries mineures, de récits-feuilletons et de gags ponctuels, les allusions à la vie des auteurs - tout cela fait de la lecture du journal une totalité.
Il y a de fait, dans mon livre, une forme d’éloge de la bande dessinée de presse, celle que l’on n’a pas choisi d’acheter comme un support noble, celle que l’on n’a pas payé très cher, et qui s’insinue dans nos vies et nos habitudes de lecteur. Avec ces journaux et magazines, le lecteur avait l’impression d’être associé à une aventure collective.
D’ailleurs, j’ai toujours trouvé stupide et agaçant le cliché qui consiste à dire que les enfants s’intéressent aux personnages et non aux auteurs de bande dessinée. Entre 10 et 15 ans, les enfants de ma génération étaient tout à fait conscients de la fabrique à l’œuvre dans ces journaux, des relations entre les auteurs, des passages d’un journal à un autre, de la vie des rédactions. Quand François Schuiten et moi avions douze ans, on avait créé un petit journal - qui n’était pas un journal de bande dessinée - et on avait voulu interviewer des auteurs…
Qui aviez-vous interviewé à l’époque ?
Ça avait commencé par une petite mésaventure, avec Roba, l’auteur de Boule et Bill ! On avait trouvé son numéro dans l’annuaire. Je nous revois, dans une cabine téléphonique, près de l’école : je prends une voix assez sérieuse et je demande une interview. Il me dit qu’il va chercher son agenda, revient, et là, ma voix, sans doute sous le coup de l’excitation, trahit ma jeunesse, et il me demande mon âge. Je réponds, pour me grandir un peu, que j’ai douze ans et demi, et il commence à me dire qu’il est très occupé, qu’il va partir en voyage, que ça va être difficile. Je sors de la cabine téléphonique et je dis à François : “C’est un con”. Des années après, quand nous avons reçu le prix du meilleur album à Angoulême pour La Fièvre d’Urbicande, j’ai rencontré Roba dans une circonstance très officielle et, comme il se réjouissait de faire notre connaissance, je lui ai raconté cette histoire, il est devenu tout rouge - c’était une vengeance à retardement, un peu cruelle !
Ensuite, j’ai rencontré Hergé, qui m’a accueilli merveilleusement. François, lui, a vu longuement Tillieux, l’auteur de Gil Jourdan, à qui il avait montré ses dessins et qui avait été d’une générosité exceptionnelle. Mais dès douze ans, on s’intéressait à ce petit monde, on saisissait des choses entre les lignes du journal. La disparition de cette presse en France n’a pas seulement bouleversé l’économie des auteurs, elle a aussi contribué à ce que la bande dessinée perde contact avec un public très large.
Les conférences que vous donnez à la BnF cet automne - et le livre qui les accompagnent - s’inscrivent dans le cycle Léopold Delisle, figure qui a marqué l’histoire de la Bibliothèque nationale et grand bibliophile : quel rapport entretenez-vous avec la collection et avec la bibliophilie ?
Non seulement je ne suis pas du tout collectionneur, mais le peu de collection que j’avais a disparu il y a un peu plus de trois ans dans l’incendie de mon appartement qui m’a obligé à être encore plus détaché de la possession. Je ne suis pas tellement dans ce fétichisme là. En revanche, que la bande dessinée entre dans une série d’ouvrages comme celle des conférences Léopold Delisle, liées à l’histoire du livre et de l’imprimé, ça me fait très plaisir. De la même façon j’ai été très heureux quand l’éditeur Citadelles et Mazenod a consacré un énorme volume à
L’Art de la bande dessinée.
Quelle place la bande dessinée occupe-t-elle aujourd’hui dans les institutions culturelles ?
Avec François Schuiten, nous avons il y a quelques années fait un don de 400 planches originales à la BnF. La Bibliothèque avait consacré une exposition à
Uderzo il y a quelques années, elle a récemment mis en ligne le
fonds Wolinski. Tous ces signes montrent que la BnF accueille la bande dessinée - d’autres institutions culturelles ne le font pas, et c’est très regrettable. Peut-être que le monde des lettres, de l’écrit, s’est montré plus accueillant envers la bande dessinée que le monde des beaux-arts… Or pour raconter l’histoire de la bande dessinée, on ne peut pas raisonner en termes de disciplines cloisonnées. Bon nombre d’écrivains et d’artistes ont aussi pratiqué le dessin, la photographie, la caricature - Nadar, Musset, Monet en sont des exemples. Ce sont ces connexions, ces réseaux, ces croisements qu’il faut prendre en compte dans l’histoire de la bande dessinée !
Propos recueillis par Mélanie Leroy-Terquem