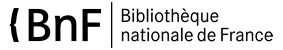À la croisée des langues et des arts
Zhang Rui, docteure en littérature chinoise, bénéficie depuis octobre 2022 d’un contrat postdoctoral dans le cadre d’un partenariat entre la BnF et le Collège de France. Chargée d’étudier un fonds rare d’estampes chinoises conservé au département des Estampes et de la photographie, elle s’attache à faire dialoguer les langues et les arts.
Comme nombre de ses amis, Zhang Rui a été marquée par la lecture d’un des Contes du lundi d’Alphonse Daudet qui figure dans les manuels scolaires chinois. « La dernière classe » raconte l’ultime leçon du maître dans une école alsacienne à la veille de l’annexion de l’Alsace-Lorraine par le Reich : « M. Hamel se mit à nous parler de la langue française, disant que c’était la plus belle langue du monde, la plus claire, la plus solide : qu’il fallait la garder entre nous et ne jamais l’oublier, parce que, quand un peuple tombe esclave, tant qu’il tient bien sa langue, c’est comme s’il tenait la clef de sa prison. » Un peu plus tard, la découverte de Balzac, lu en traduction, puis l’apprentissage du français à l’université de Pékin scellent le lien de la jeune femme à « la plus belle langue du monde ».
Le détour par le français
Zhang Rui se met à écrire des poèmes en français et participe en 2012 à un concours de poésie. « Mon texte était inspiré par la figure d’Écho, la nymphe amoureuse de Narcisse et empêchée de lui dire son amour, parce que condamnée à répéter les derniers mots entendus, se souvient-elle. Il s’intitulait “Je n’osais pas lui dire”. » Là encore, il est question de « tenir sa langue ». Lauréate du concours, elle est invitée à passer dix jours à Paris. C’est son premier séjour en France, où elle reviendra poursuivre ses études de français et de littérature comparée, à Reims puis à Paris. Dans le va-et-vient entre sa langue maternelle et celles qu’elle apprend au fil du temps – l’anglais, le français, le grec moderne –, l’étudiante trouve un espace d’épanouissement intellectuel. Quand elle entame en 2015 une thèse portant sur l’évolution d’une forme poétique chantée dans la Chine du haut Moyen Âge, elle choisit de le faire en France, à l’Inalco, et en français. « Travailler en chinois sur la littérature classique chinoise ne m’aurait pas permis le recul nécessaire, explique-t-elle. Je ne saisis vraiment les nuances d’un texte que lorsque je tente de le traduire. » Pour illustrer son propos, elle raconte la fois où, lors d’un séminaire avec des sinologues français, elle parvient à déchiffrer un passage obscur d’un ouvrage encyclopédique du XIe siècle. « Le détour par la langue française m’a permis de me pencher sur l’énigme qui se cachait dans un caractère chinois : il détenait la clé pour comprendre ce qui faisait obstacle à notre lecture. J’ai dessiné au tableau ce que j’avais saisi, je l’ai expliqué en français. J’avais l’impression de dialoguer avec un auteur ayant vécu mille ans auparavant, ça m’a beaucoup marquée. » Est-ce ce rapport intime à la langue et aux mots qui lui permet ainsi de traverser les frontières temporelles et géographiques ? Elle explique son attachement de longue date à la poésie classique chinoise en citant Confucius (« Jeunes gens, rien ne vaut l’étude de la poésie ! »), et insiste sur les multiples composantes qu’elle convoque – calligraphiques, picturales, musicales.
Le fonds chinois de la collection Curtis
L’intérêt de Zhang Rui pour la transversalité des arts dans la Chine ancienne, développé dans sa thèse de doctorat, trouve un terrain d’études à sa mesure dans la collection d’Atherton Curtis (1863-1943), conservée au département des Estampes et de la photographie de la BnF. Ce collectionneur américain, installé en France au tournant des XIXe et XXe siècles, acquiert en quelques décennies une collection d’estampes colossale, tant par le nombre de pièces (plus de 10 000) que par la diversité des époques et des aires géographiques représentées – de Rembrandt à Steinlein et Forain, en passant par Dürer, Daumier ou Hokusai. Dans les années 1930, il effectue plusieurs donations au Louvre, au musée de Cluny, au musée Guimet et au musée d’Art moderne, et lègue à la Bibliothèque nationale sa collection d’estampes. En son sein, un millier de pièces d’art chinois, pour lequel Curtis s’était pris de passion à la fin de sa vie. C’est cet ensemble, qui couvre toute l’histoire de la gravure chinoise, que Zhang Rui entreprend d’identifier et de décrire dans le cadre de son contrat postdoctoral, avec le soutien de la professeure Anne Cheng. Au seuil de cette exploration, elle s’émerveille devant la richesse et la variété des pièces rassemblées dans le fonds : « On y trouve bien sûr quantité d’estampes, mais aussi des estampages et des volumes d’une grande variété – des ouvrages précieux datant de l’époque des Ming (1368-1644), des sutras et des apocryphes bouddhistes, ainsi que des albums et des manuels, des dessins et des peintures. » Son travail vise, à terme, à rendre accessible dans Gallica les œuvres numérisées. En attendant leur mise en ligne, quelques-unes d’entre elles, sélectionnées par Zhang Rui avec l’assistance de Corinne Le Bitouzé, adjointe à la directrice du département des Estampes, seront exposées dans le musée de la BnF à l’occasion du colloque sur la sinologie française qu’organisent pour octobre 2024 la BnF et le Collège de France.
Mélanie Leroy-Terquem
Article paru dans Chroniques n° 98, septembre-décembre 2023