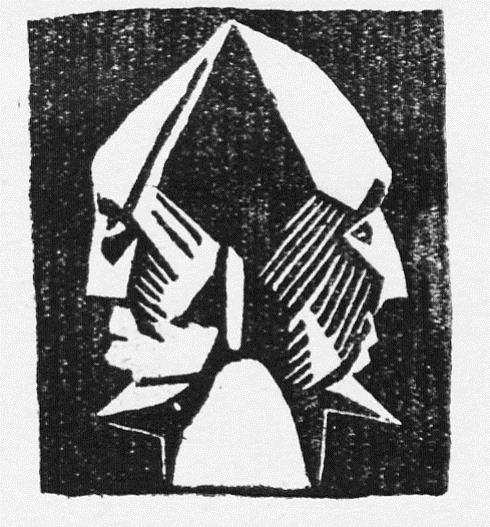Risque de perturbations des services au public le samedi 26 avril 2025, en raison d'un mouvement social
Littérature africaine anglophone d'aujourd'hui
Reportée en 2021 en raison de la pandémie, la manifestation Africa 2020 vise à promouvoir notamment les arts et les littératures du continent africain. À cette occasion, la Bibliothèque nationale de France présente, en salle G de la Bibliothèque tous publics, une sélection d’ouvrages de littérature contemporaine d’Afrique subsaharienne en langue anglaise.
Une vitalité littéraire et créatrice
Depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, la littérature africaine anglophone bénéficie de plus d’attention de la part du monde littéraire. La création de revues, comme Kwani ? (Kenya) ou Chimurenga (Afrique du Sud), la fondation de maisons d’édition, comme Cassava Republic (Nigéria) et l’émergence de nouvelles voix littéraires sont la preuve d’une vitalité littéraire et créatrice, désignée parfois de « renaissance ». Pour les auteurs, il arrive qu’on parle d’écrivains de « troisième génération ».
Si cette qualification est sans doute réductrice, il est cependant possible de dégager certains traits et tendances qui distinguent ces textes de ceux des générations précédentes, sans qu’il soit pourtant question de rupture.
Après les indépendances
La question de la violence de la société postcoloniale, l’échec d’une construction sociétale équitable après l’indépendance et parfois les guerres civiles sont parmi les thèmes récurrents. Mentionnons ainsi l’évocation de la guerre du Biafra dans nombre de romans nigérians, tels que L’autre moitié du soleil de l’autrice Chimamanda Ngozi Adichie et Sous les branches de l’udala de Chinelo Okparanta. La violence de certains régimes d’après l’indépendance revient aussi régulièrement, comme on peut lire dans En attendant un ange de Helon Habila ou dans Il nous faut de nouveaux noms de NoViolet Bulawayo. La romancière et cinéaste zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga évoque, elle aussi, dans son dernier roman, This mournable body, la descente aux enfers de son pays après l’indépendance. Dans Bêtes sans patrie d’Uzodinma Iweala et Comptine pour l’enfant-soldat de Chris Abani, la violence vécue par les enfants-soldats constitue le thème central.
La romancière sud-africaine Kopano Matlwa décrit dans Coconut la pauvreté et le racisme post-apartheid de son pays en brossant un portrait contrasté de deux jeunes femmes. La jeune Mvelo, le personnage principal du roman Enrage contre la mort de la lumière de Futhi Ntshingila, vit la violence et la misère des bidonvilles d’Afrique du Sud où elle habite seule avec sa mère Zola. Niq Mhlongo, lui, représentant de la génération hip-hop, appelée kwaito, décrit les défis de la société sud-africaine en transition et les conditions de vie des Noirs, thème que l’on retrouve également chez Kgebetli Moele dans Chambre 207.
Explorer le passé
Une exploration d’un passé parfois plus lointain marque notamment les romans Kintu de Jennifer Nansubuga Makumbi (Ouganda), Sous le regard du lion de Maaza Mengiste (Éthiopie), No home de Yaa Gyasi (Ghana/États-Unis) ou encore Hors des ténèbres, une lumière éclatante de Petina Gappah (Zimbabwe). Ce récit du transport du corps de l’explorateur Livingstone sur plus de 2 500 km du centre vers la côte Ouest de l’Afrique afin qu’il soit rapatrié en Angleterre est raconté par deux de ses serviteurs, dont la cuisinière africaine Halima. Comme on le voit dans ce roman, les romancières donnent voix aux femmes et témoignent de leur position dans la société, par exemple dans Les vierges de pierre d’Yvonne Vera (Zimbabwe). Elles abordent parfois aussi la question du genre, comme Akwaeke Emezi (Nigéria) dans Eau douce.
Akwaeke Emezi lie, dans ce roman, la question du genre et de l’identité à des éléments de croyances igbo. Ces dernières sont également présentes chez Chigozie Obioma dans Les pêcheurs et La prière des oiseaux. De son côté, Helen Oyeyemi, dans La petite Icare, confronte son personnage principal à la spiritualité africaine lors de sa première visite, assez troublante, au Nigéria, pays d’origine de sa mère.
Cosmopolitisme
Dans ce roman émerge la question d’un entre-deux culturel et social et des appartenances multiples. La migration et le cosmopolitisme sont effectivement récurrents dans les romans africains anglophones contemporains. Ces thèmes, qui reflètent souvent la réalité d’auteurs faisant partie de la diaspora africaine, se retrouvent par exemple dans Harare Nord de Brian Chikwava (Zimbabwe), Le conte du squatteur d’Ike Oguine (Nigéria) ou encore dans Voici venir les rêveurs d’Imbolo Mbue (Cameroun) où les personnages d’origine africaine tentent tant bien que mal de construire leur vie à l’étranger.
Enfin de nombreux romans se caractérisent aussi comme des romans d’apprentissage. Citons L’hibiscus pourpre de la célèbre autrice Chimamanda Ngozi Adichie (Nigéria), Le meilleur reste à venir de Sefi Atta (Nigéria), Graceland de Chris Abani (Nigéria), Il nous faut de nouveaux noms de NoViolet Bulawayo (Zimbabwe) ou encore À fleur de peau de Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), dont on retrouve le personnage principal, des années plus tard, dans son dernier roman, This mournable body. Le jeune Tshepo, lui, dans La sourde violence des rêves de K. Sello Duiker plonge dans la dépression en frôlant la folie, et par le biais de la prostitution explore sa sexualité. Le roman dresse un tableau de la culture de la jeunesse et de ce que cela signifie d’être jeune en Afrique du Sud.