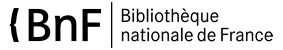Maylis de Kerangal
Maylis de Kerangal est née le 16 juin 1967 à Toulon, dans une famille bretonne de capitaines au long cours dans la marine marchande ; elle passe son enfance au Havre, avant des études à Paris (classes préparatoires littéraires, puis cursus d’histoire, de philosophie et d’ethnologie) : « Ma maîtrise portait sur les cartographes, les cosmographies de la Renaissance, j’ai passé un an au département des Cartes et plans à la bibliothèque Richelieu, un souvenir inoubliable. » (2014). Elle travaille ensuite dans l’édition, d’abord chez Gallimard, où elle publie des guides de voyage, puis aux éditions jeunesse du Baron perché, qu’elle crée en 2004.
Après un séjour aux États-Unis, elle publie en 2000 aux éditions Verticales son premier roman, Je marche sous un ciel de traîne, puis La Vie voyageuse (2003). Elle participe ensuite très largement à la revue et aux éditions du collectif d’écrivains Inculte. Elle dit elle-même avoir trouvé une façon d’écrire plus personnelle avec ses nouvelles Ni fleurs ni couronnes (2006) puis Dans les rapides (Naïve, 2006) :
« Après mes deux premiers romans, tous les deux écrits avec un « je » narratif, quelque chose s’est déchiré et éclairci en même temps : le refus de passer par l’introspection. Quelque chose alors s’est ouvert, que j’ai conservé. Je me suis calée dans une écriture où je décris tout ce qui se passe. J’ai trouvé une très grande joie dans la description. » (2014)
En 2008, Corniche Kennedy rencontre un plus large public et figure, déjà, dans la sélection de plusieurs prix littéraires. En 2010, elle reçoit le prix Médicis pour Naissance d’un pont, grand roman épique. Tangente vers l’est (2012), récit d’un voyage en Transsibérien, est à l’origine une pièce radiophonique, Lignes de fuite, diffusée sur France Culture en cinq épisodes en août 2010.
Réparer les vivants (2014) a rencontré un large public et reçu de nombreux prix, dont le Grand prix RTL-Lire et la première édition du Roman des étudiants France Culture-Télérama. Ce beau roman métaphysique, dont le titre est repris d’une réplique de Tchekhov :
« (…) dans son bureau, au revers de la porte, il a scotché la photocopie d’une page de Platonov, pièce qu’il n’a jamais vue, jamais lue, mais ce fragment de dialogue entre Voïnitzev et Triletzki, récolté dans un journal qui traînait au Lavomatic, l’avait fait tressaillir comme tressaille le gamin qui découvre la fortune, un Dracaufeu dans un paquet de cartes Pokémon, un ticket d’or dans une tablette de chocolat. Que faire Nicolas ? Enterrer les morts et réparer les vivants. » (Réparer les vivants, p. 132-133)
est un livre de transports et de passages, de la vie à la mort à la vie, qui dure précisément 24h et raconte la greffe d’un cœur. La romancière y explore le langage technique et le monde clos du milieu médical tout en restituant de manière très subtile des émotions puissantes et complexes.
Son dernier roman à ce jour, Un monde à portée de main (2018) s’intéresse à la matière, aux gestes et aux mots de la peinture, à travers l’apprentissage des techniques de l’illusion puis les chantiers que mène à bien une créatrice de décors en trompe-l’œil et de copies plus que parfaites. Par la fiction, en peinture comme en littérature, on accède à une forme de vérité.
Une écriture du corps dans l’espace
Deux et bientôt trois des romans de Maylis de Kerangal ont été adaptés au cinéma : Réparer les vivants par Katell Quillévéré (novembre 2016), Corniche Kennedy par Dominique Cabrera (janvier 2017) et Naissance d’un pont, en tournage par Julie Gavras. Cela est dû, sans doute, au fait que son écriture, à travers des sujets très variés, est extrêmement physique et sensorielle. C’est une écrivaine du corps dans l’espace, avec une palette géographique très large ; elle voyage et observe, en ethnologue mais avec beaucoup de tendresse, des personnages qui tentent de se créer des espaces de fuite. Elle réintroduit l’épopée, le western et l’aventure dans le roman français : « À l’origine d’un roman, j’ai toujours des désirs très physiques, matériels. Et une envie d’espaces. Tant qu’il n’y a pas les espaces, il n’y a pas de livre possible. » (2014).
Mais son écriture est également très travaillée et littéraire, comme le montre la façon dont elle décrit sa phrase :
« Depuis Ni Fleurs ni couronnes, je stabilise une forme de phrase qui tente d’être totale, comme un filet que je lance et tire, un peu attrape-tout. On peut la voir comme une vaste description, mais qui agrège du dialogue, de la pensée, et la description elle-même n’est jamais seulement la consignation d’un décor, j’essaie qu’elle soit une décharge vivante, d’y faire fluctuer, à l’intérieur d’un même milieu, la température, les espaces, la lumière, les actions des protagonistes, les dialogues qu’ils échangent. De fait, elle est longue, mais elle se redéclenche, elle rebondit. » (2012)
ou la manière dont elle mêle les langages et travaille la langue un peu comme si elle lui était étrangère :
« J’aime aussi rapatrier dans la langue littéraire des mots étrangers à la littérature : le langage des chantiers, de la médecine, des ados. Un jour, je me suis retrouvée à Arles, au collège des traducteurs, et quelqu’un m’a interpellée : « Mais vous n’êtes pas traductrice, que faites-vous là ? » Pour rire, j’ai répliqué : « Si, je suis traductrice ! » Puis j’ai réfléchi à cette plaisanterie : oui, j’étais traductrice, en ce sens que je traduis mon français – je ne parle pas comme j’écris. Parfois, quand je regarde mon livre une fois qu’il est rédigé, les phrases me paraissent étrangères. Je les ai écrites, mais elles ont été produites dans un moment de traduction, qui passe par un enrichissement : aller chercher de la préciosité, le mot rare, le faire affleurer de l’oralité. Cela donne ce français étranger, ce français qui n’est pas ma langue maternelle. » (2014)
En lisant en écrivant
Maylis de Kerangal souligne son goût pour les rencontres avec ses lecteurs :
« J’ai toujours aimé le contact direct avec le lecteur. Souvent, je vais dans les collèges ou les lycées rencontrer des élèves qui n’ont jamais croisé d’auteurs vivants. C’est pour moi une façon d’incarner auprès d’eux l’idée qu’il y a des gens qui écrivent aujourd’hui. Il est intéressant de voir que ces jeunes lecteurs associent énormément la figure de l’auteur et la figure du héros ; je me souviens par exemple que, pour Corniche Kennedy, ils me demandaient souvent si je faisais du plongeon comme les personnages. Cela me renvoie à la façon dont moi, Maylis, suis présente dans mes livres, et aux dispositifs et aux évitements que je mets en place pour y apparaître ou en disparaître. » (2014)
et insiste également sur l’importance de ses lectures et les multiples réminiscences littéraires qui nourrissent son écriture : « Le carburant de mon écriture ce sont mes lectures, j’ai vraiment le sentiment d’écrire à travers ces langues, à travers ces voix » (2016). Sa lecture des écrivains qu’elle aime est d’ailleurs également très physique : en témoigne la manière dont elle évoque celle de Claude Simon par exemple :
« Je lis Claude Simon comme un épaulement : mouvement de danse – quand le corps à la fois se désaxe et progresse vers l’avant ; soulèvement – quand une archive géologique hausse et déplace ; influence – quand un corps vient se placer au contact et transmet sa puissance. (…) L’écriture de Claude Simon ne relève pas d’une compétence, elle est d’abord une expérience : on est soudain placé devant le langage – « devant » au sens visuel du terme, au sens de la frontalité, au sens d’être en face, dans un face à face. C’est un moment impressionnant. Le langage est là, un soulèvement, et de l’épaule je m’y avance, en me désaxant j’y entre. C’est un moment charnel. Plus rien ne m’est caché, il n’y a pas de secret, pas de double-fond : tout est là. » (2016) ou « J’aime la phrase de Simon, elle est admirable, parce que, comme dit Gilles Deleuze, elle ne fait pas le point. Ce n’est qu’une ligne de fuite. (…) Pour les fins de mes livres (…) je suis du côté de Simon : ce sont des fins en horizon, très ouvertes. Dans un certain sens, je ne finis pas mes livres, comme Claude Simon ne finissait pas ses phrases : il ne s’agit pas de clore, de résoudre quoi que ce soit, ou de refermer une intrigue. En fin de livre, je cherche un moment d’ouverture totale, face auquel un mouvement de sidération arrêterait le texte et la phrase, comme de la pellicule qui cramerait soudain. » (2012)
Texte initialement publié en 2017 dans le Blog Lecteurs de la BnF .