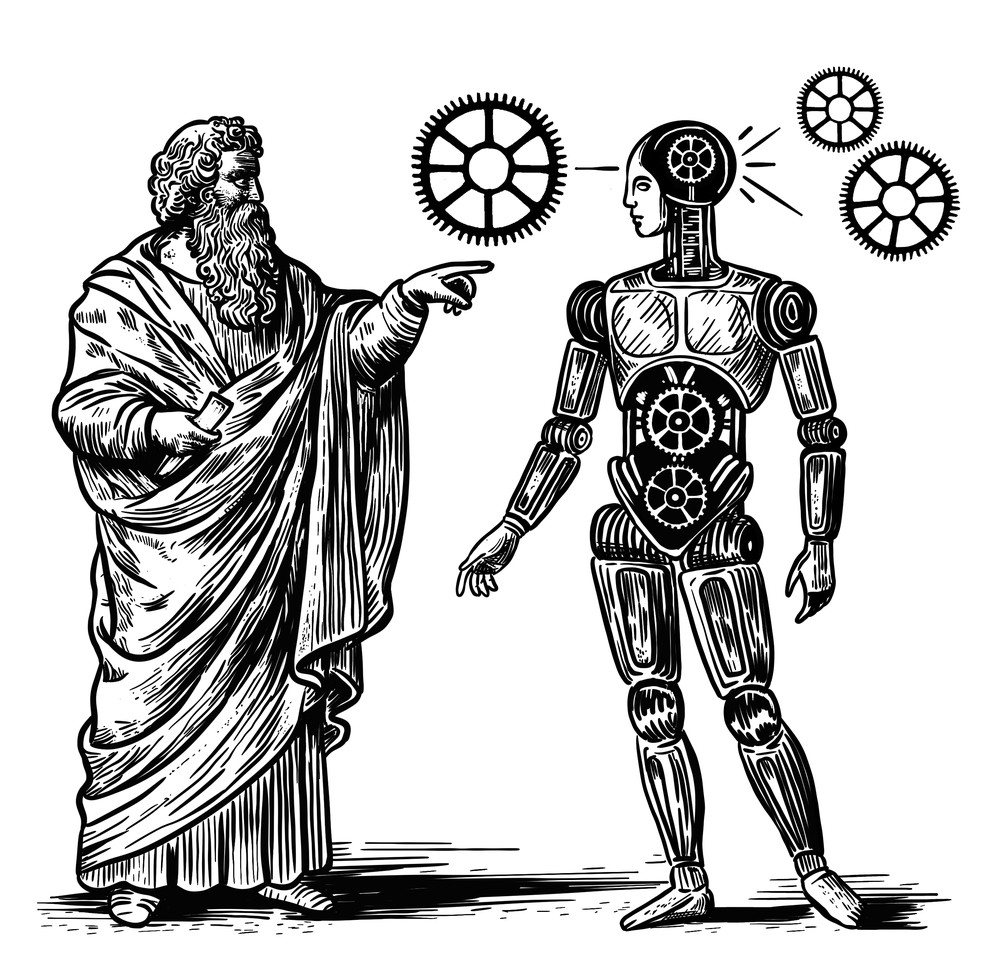Pour une culturelle histoire de l’IA
Sortir d’une vision polarisée et caricaturale de l’intelligence artificielle penseur de l’innovation en l’inscrivant dans l’histoire des outils techniques, tel est l’objectif d’une journée d’étude qui se propose d’explorer l’IA du point de vue de l’histoire culturelle. Entretien avec Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS, organisateur de cette manifestation.
Chroniques : Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l’histoire culturelle de l’IA ?
Alexandre Gefen : J’ai découvert l’IA au printemps 2016 à travers la discipline des humanités numériques, alors que j’étais en mission à l’université de Stanford au sein du laboratoire littéraire fondé par Franco Moretti. Nous assistions à la naissance des premiers outils basés sur l’apprentissage automatique capables de créer du contenu à partir des textes, de les faire parler en quelque sorte : j’ai été fasciné ! Cela m’a conduit, plus tard, lorsque les IA génératives sont devenues des outils accessibles et largement diffusés, à organiser plusieurs programmes de recherche. Ainsi, la journée d’étude organisée à la BnF s’inscrit dans le cadre du projet CulturIA, financé par l’Agence nationale de la recherche, qui étudie l’histoire culturelle de l’intelligence artificielle, de sa « préhistoire » aux développements contemporains.
Les développements de l’IA sont-ils en voie de modifier notre vision de la culture ?
L’IA peut être définie comme l’ensemble des méthodes mathématiques et des technologies informatiques destinées à résoudre des problèmes habituellement traités par l’esprit humain, depuis l’accompagnement des tâches humaines que permettent les outils numériques jusqu’à l’horizon du remplacement de l’homme par une « IA générale » capable de produire des raisonnements. Depuis les automates d’Héron d’Alexandrie au 1er siècle avant J.-C., cette évolution technologique est un objet de fantasmes, dans le champ des sciences comme dans celui des arts. Les développements récents de l’intelligence ar tificielle ont alimenté d’intenses débats qui questionnent les représentations des frontières entre le vivant et la machine, les notions d’autonomie et de créativité… Notre rapport à la mémoire, nos catégories philosophiques, éthiques et esthétiques sont interrogés. Pour comprendre les dilemmes moraux et politiques que pose l’IA, il m’apparaît pertinent de l’envisager comme un objet culturel en tant que tel, riche de sa propre histoire.
Que révèle l’histoire des représentations de l’intelligence artificielle ?
La préhistoire de l’IA s’est incarnée dans des objets matériels, de la calculatrice astronomique d’Antikythera aux ordinateurs, en passant par la Pascaline, le moteur analytique du mathématicien Charles Babbage, le piano logique de William Stanley Jevons ou le joueur d’échecs de Leonardo Torres Quevedo. Son essor s’accompagne également d’images et de fictions, de la créature du Golem à Blade Runner, de la légende des Géants de bronze de Talos à Terminator. Par ailleurs, elle alimente un renouveau remarquable de la création littéraire et artistique contemporaine, représentée par exemple par les artistes français Justine Emard et Gregory Chatonsky. Explorer les imaginaires de l’IA est un enjeu crucial au regard des questionnements éthiques et politiques qu’elle soulève. Réinscrire l’intelligence artificielle dans l’histoire culturelle peut nous aider à nous extraire de l’alternative caricaturale entre pessimisme noir et optimisme naïf : c’est ce que nous chercherons à montrer lors de cette journée d’étude.
Propos recueillis par Sylvie Lisiecki
Article paru dans Chroniques n° 103, avril-juillet 2025