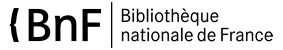Réconcilier les mémoires
Chroniques : Qu’attendez-vous de ce colloque sur les oppositions intellectuelles à la colonisation algérienne ?
Benjamin Stora : Qu’il permette de transmettre au plus grand nombre et notamment aux jeunes générations une vision élargie de cette période assez ignorée de notre histoire. L’enjeu est notamment de mieux faire connaître les voix de ceux qui se sont opposés à la colonisation.
À partir de quand et sous quelles formes se sont exprimées les premières voix contre le colonialisme en France ?
Les premières critiques se font entendre au XIXe siècle, émanant de courants et de sensibilités divergentes. Il existe une opposition nationaliste à la colonisation, autour de l’idée que le pays doit se concentrer sur son territoire propre, récupérer par exemple l’Alsace-Lorraine et non se disperser avec les colonies. Des voix s’élèvent contre la colonisation au nom de la morale et des droits de l’homme et critiquent la brutalité du système. Et, dans l’entre-deux guerres un courant anti-impérialiste se développe, lié au communisme, qui porte attention aux cultures du Sud. Mais ces courants sont parfois brouillés et porteurs d’ambiguïtés ; ainsi Jean Jaurès ne prend conscience que progressivement des questions posées par la colonisation française alors que Georges Clemenceau y est d’emblée farouchement opposé. Dans le même temps, des artistes comme André Breton, Louis Aragon et les surréalistes valorisent les cultures du Sud qu’ils considèrent comme des sources d’inspiration. À rebours d’un regard ethnographique, ces cultures de l’autre, méprisées et disqualifiées, sont pour eux un moyen d’accès aux couches les plus profondes de l’humain dans son caractère universel. Pablo Picasso s’engage fermement aux côtés des anticolonialistes : il dresse le portrait, en février 1962, de Djamila Bouchapa, militante algérienne torturée et violée durant sa détention. Le dessin fait la couverture du livre plaidoyer de Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi en faveur de la militante algérienne, publié aux éditions Gallimard.
La question de l’Algérie a profondément divisé les intellectuels français. Comment s’est dessinée selon vous la ligne de fracture entre ceux qui se sont prononcés pour « l’Algérie française » et ceux qui se sont opposés à la guerre jusqu’à se déclarer favorables à l’indépendance ?
Le courant dominant chez les intellectuels et dans l’Université française est favorable à la colonisation, pour la « Grande France », même si certains s’interrogent sur les méthodes mises en œuvre. Ainsi, un homme de gauche comme Jacques Soustelle était favorable à l’aménagement de droits pour les colonisés. Pourtant, après le massacre de 1955 il devient partisan de la répression. Les voix qui s’expriment pour l’indépendance, comme celles de François Mauriac, Paul Ricœur ou Jean-Paul Sartre, sont très minoritaires.
Les prises de position d’Albert Camus, qui ne s’est jamais déclaré pour l’indépendance algérienne mais préconisait une réconciliation, lui ont été beaucoup reprochées par les deux camps. Quel regard portez-vous sur sa position ?
Camus est anticolonialiste, mais il l’est par souci de retour aux origines de la République et des droits de l’homme. Il est contre la brutalité coloniale et a été le seul intellectuel français à condamner les massacres de Sétif en 1945. Pour lui, la possibilité existait d’une Algérie réconciliée. Il ne pensait pas que l’indépendance pouvait régler la question. Il n’a pas compris qu’on avait changé d’époque, qu’on était entré dans une époque de durcissement idéologique et s’est retrouvé dans une grande solitude. Il ne pouvait pas se rallier à l’Algérie française et il ne pouvait pas non plus épouser le point de vue de Sartre, notamment parce qu’il était un fervent défenseur de la démocratie et qu’il pressentait que ce mouvement allait construire un pays avec un parti unique. Il était pour une Algérie liée à la France de manière démocratique. Mais il était trop tard. La France était restée trop longtemps en Algérie dans une position de domination absolue, une forme de colonisation très dure qui privait les indigènes de tous droits. Il y avait trop de ressentiment accumulé et cela ne pouvait se défaire que par la violence.
Comment expliquez-vous que les questions de l’indépendance et de la guerre d’Algérie soient si peu présentes dans les représentations et dans l’imaginaire collectif en France ?
Le conflit algérien a mis en crise le sentiment national et l’identité française. Depuis plus d’un siècle, l’Algérie était rattachée administrativement à la France, c’était un département français ! Cette crise, le général De Gaulle a réussi à la juguler en faisant croire aux Français que leur pays restait une grande puissance. Par ailleurs, de 1950 aux années 1990, les Trente Glorieuses ont emporté les Français dans la dynamique de la société de consommation, sans oublier les bouleversements qui ont suivi l’explosion de 68 incarnée par la jeunesse. Personne n’avait envie de ressasser cette guerre. Et toute cette mémoire blessée s’est réfugiée dans les livres, alors qu’elle avait disparu de l’espace public, des commémorations, des représentations, des manuels scolaires. Voyez l’immense succès des quatre tomes de La Guerre d’Algérie d’Yves Courrière, sortis entre 1968 et 1971, qui se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires. De très nombreux récits ont été publiés, des récits de femmes, d’appelés, et ensuite d’enfants de pieds-noirs et de harkis. Tous racontent les souffrances de leurs parents, voire, depuis deux ou trois ans, de leurs grands-parents, à l’image de L’Art de perdre d’Alice Zeniter [qui raconte l’histoire d’une famille de harkis sur trois générations]. Ainsi s’est mise en place une transmission souterraine, secrète, inavouée, qui continue aujourd’hui encore.
Face à la guerre mémorielle que se sont livré l’Algérie et la France et en regard de la « politique de l’oubli » qui a longtemps prévalu dans notre pays, comment définissez-vous le rôle et la responsabilité de l’historien que vous êtes ?
L’historien doit être un lanceur d’alerte, un éveilleur. C’est un passeur qui essaie par la connaissance, le savoir, de faire en sorte que le fossé soit moins grand entre les visions des uns et celles des autres. C’est un homme qui jette des ponts entre les consciences.
Propos recueillis par Sylvie Lisiecki
Version longue de l’entretien paru dans Chroniques n° 93, janvier-mars 2021
Pour aller plus loin : Benjamin Stora, France-Algérie, les passions douloureuses, éditions Albin Michel, 2021